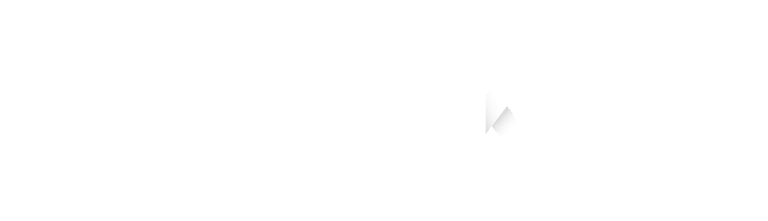Agriculture biologique, durable, intégrée, conventionnelle, intensive, raisonnée… Un bon nombre de qualificatifs sont employés pour décrire les modes de production. Et les produits alimentaires associés. Or, quelle valeur y accorder ? Faisons le point entre deux modes de production : l’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée.
Côté exploitations ?
Une conduite de l’exploitation plus ou moins stricte
L’agriculture biologique est un mode de production validé par des instances publiques et contrôlé par des organismes certificateurs agréés. Il exclut l’utilisation d’OGM et de produits chimiques (engrais et produits phytosanitaires). Les intrants de synthèse type traitements vétérinaires ou produits de lavage sont limités. Pour les élevages, les normes exigent des conditions supérieures à celles d’une agriculture conventionnelle avec par exemple un accès à l’extérieur des bâtiments. Pour quels objectifs ?
Le respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien être animal.
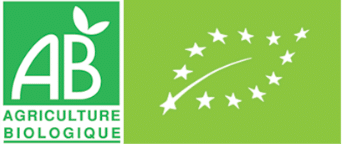
Contrairement à l’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée peut utiliser de produits chimiques de synthèse ou encore des OGM. Introduite en 1993 par l’association FARRE (Forum des Agriculteurs Responsables Respectueux de l’Environnement), l’agriculture raisonnée consiste en un équilibre entre la production et le respect de notre environnement. Ceci se fait par l’intermédiaire d’une optimisation de l’emploi des intrants (en évaluant la pression des ravageurs, la présence d’auxiliaires…) tout en préservant la rentabilité économique des exploitations. En effet, des doses réfléchies de produits de synthèse évitent une surconsommation, et, par conséquent, un surcoût économique. Tout en réduisant les effets néfastes sur la faune et la flore.
Les certifications associées
Ce mode de production initialement non restreint en termes d’utilisation de pesticides, est aujourd’hui encadré par décret et peut être porté par des certifications telle que la certification HVE, « Haute Valeur Environnementale ». HVE fixe effectivement des exigences sur l’emploi de phytosanitaires, sur la gestion des ressources en eau ou encore sur la protection de la biodiversité. Du point de vue des agriculteurs et viticulteurs, cette certification peut représenter un pont vers une production AB, plus risquée et exigeante. Autre label : CAB, Conversion Agriculture Biologique, se destine aux viticulteurs occitans en transition.
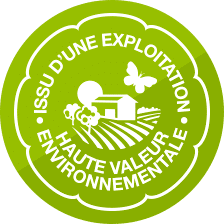

Un tournant vers le bio pour les agriculteurs français
En plein essor en France, la surface agricole utile de l’agriculture bio en 2018 a atteint les 7,5 %, soit deux millions d’hectares cultivés par 9,5 % des agriculteurs français. Une hausse de 31 % par rapport à 2017. Objectif ? Atteindre les 15 % de SAU1 fin 2022. De nombreux paramètres sont à l’origine de ce constat : ouverture de moulins et de silos dédiés, augmentation des capacités de traitement et de stockage… En viticulture, on décompte 12 % du vignoble en bio en 2018. 40 % des cultures de légumes secs affichent déjà le label AB.
Des associations à nuancer
Gare aux associations hâtives : le bio n’est pas systématiquement « meilleur » que le raisonné vis-à-vis du mode de production. Citons le milieu viticole : la viticulture bio, pour lutter contre le mildiou (champignon attaquant les vignes), gorge les sols de cuivre. Or, le cuivre représente un problème environnemental car il amène, en grande quantité, une stérilisation des sols sur le long terme.
D’autre part, l’agriculture raisonnée répond aux contraintes de consommation moderne, c’est-à-dire de la qualité mais aussi beaucoup de volume. La production bio étant encore insuffisante pour répondre à l’explosion de la demande de produits durables.
Côté rayons ?
De véritables cautions à l’achat
Démarche lancée par l’agriculture conventionnelle, l’agriculture dite raisonnée peut être perçue comme étant du greenwashing. Or, les certifications associées telles que HVE représentent de véritables cautions pour les consommateurs. Elles sont d’ailleurs aujourd’hui de plus en plus demandées par les distributeurs. Les foires aux vins se sont ainsi parées du label HVE faute de volumes suffisants en bio.

Le bio gagne également le cœur des français : en 2018, 71 % se tournent vers le bio au moins une fois par mois2. Leur principale motivation ? La santé ! Pour 69 % d’entre eux. La qualité et le goût des produits arrivent en deuxième position, suivie de la préservation de l’environnement pour plus d’1 français sur 22.
Les marques déploient ainsi leurs gammes biologiques qui fleurissent dans nos rayons. Avec un chiffre d’affaire de près de 10 milliards d’euros en 2018, et une hausse potentielle de 50 % d’ici 4 ans, le marché est attractif !
Les marques encouragent ces modes de production
La valorisation d’une agriculture raisonnée est ainsi portée par les acteurs de l’agro-alimentaire. Dans le secteur du vin, les distributeurs valorisent les labels autre que celui de l’agriculture biologique : HVE, Terra Vitis, Agri Confiance s’invitent dans les rayons, cautions d’une agriculture durable, et, par extension, raisonnée.
Pour le bio, et plus particulièrement la conversion au bio, les marques n’hésitent pas à valoriser la démarche. Prenons l’exemple de Leclerc avec « Récoltons l’Avenir », gamme de cidre et jus de pomme élaborés avec des fruits récoltés au cours des 2ème et 3ème année de conversion en bio. De même pour Picard ou encore D’Aucy, ce dernier invitant le public à participer à sa future gamme de conversion.

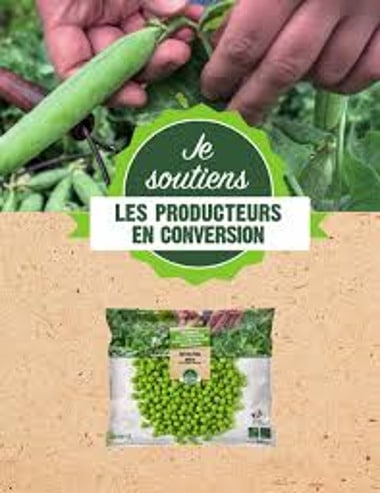
Une cohérence essentielle sur les produits issus de ces modes de production
Attention toutefois à garder une cohérence entre les produits et les valeurs véhiculées. Consommateurs, associations et syndicats y portent une attention particulière, et n’hésitent pas à dénoncer des aberrations. Citons les produits bio importés d’outre-Atlantique, contre-sens lié aux émissions de CO2 induites par le transport, ou la déforestation nécessaire à sa production. Rappelons d’ailleurs qu’un tiers des produits bio sont importés. L’affaire des serres chauffées pour la production de tomates bio hors saison est un autre exemple.

Côté agriculture raisonnée, des pommes Leclerc certifiées HVE ont fait l’objet d’une pétition. Le suremballage lié au produit étant une incohérence avec les valeurs portées par le label.
Autre point d’attention : l’agriculture raisonnée et les labels associés représentent une alternative à l’agriculture biologique. Seulement le « cadre » entourant ces nominations restent encore flou et amènent une méfiance de la part du consommateur, telle une concurrence déloyale. Pour gagner la confiance en rayon, la transparence est de mise pour ce modèle agricole.
Autre débat : les claims associés aux modes de production. Représentent-ils un gage de qualité au regard de ce qu’ils énoncent ? Entre « Zéro résidu de pesticides », « 100 % naturel » ou « meilleur pour la santé, l’équipe rédaction vous décrypte le vrai du faux.
- SAU : Surface Agricole Utile
- Baromètre de consommation et perception des produits biologiques en France – Agence Bio / Spirit Insight – Février 2019